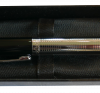Le 1er mai 1847, l’hôtel de ville de Paris resplendissait pour la fête du roi Louis Philippe. Deux écrivains, Gustave Flaubert et Maxime du Camp, âgés de 25 ans seulement, tournent le dos à la célébration de cette monarchie finissante pour sauter dans un train en direction de la Loire. Pendant une vingtaine de jours, les deux amis descendent le fleuve jusqu’à Saint-Nazaire avant d’entreprendre, trois mois durant, un tour de la Bretagne immortalisé dans Par les champs et par les grèves, un récit de voyage écrit à deux mains et publié dans son intégralité à titre posthume en 1881.
Les deux hommes se sont rencontrés à Paris en 1843. Après le décès de son père, la fin de ses études laborieuses et la publication d’une première version de L’Éducation sentimentale, Flaubert propose à son ami du Camp de partir. L’un et l’autre nourrissent une passion pour le voyage. Le premier en a fait l’expérience en Corse et dans les Pyrénées, le second a déjà frotté sa rétine à l’exotisme de l’Orient en visitant l’Anatolie et l’Algérie .
Vingt jours après leur départ de Paris, ils passent La Vilaine à la Roche Bernard et entrent dans un territoire non moins exotique où la langue française se fait rare. Qu’importe ! Flaubert sort de sa besace une carte et un compas et s’oriente grâce au soleil.
Sur les quais d’Auray, ils embarquent sur une lourde chaloupe. À Belle-Ile, sans guide ni renseignement quelconque (« c’est là la bonne façon » précise Flaubert), les deux voyageurs prennent la clef des champs pour jouir librement du spectacle des rochers battus par la marée et des tourbillons d’écume. Chacun leur tour, ils mélangent des descriptions topographiques à l’histoire locale et aux scènes de vie dont ils sont les témoins.
De retour sur le continent, ils gravitent de longues heures autour de la ville « fort coquette » de Quimper. XIXe siècle oblige, leur attention se porte sur les ruines, ici la chapelle de Kerfeunteun, là l’ancien prieuré de Loc-Maria ou encore les champs mégalithiques de Carnac desquels émane un « charme singulier ».
Voyageant à pied et à un cheval, ils se contentent de peu, mangent du pain dur avec un peu de lard et dorment dans des auberges au confort plus que spartiate. Certains soirs, harassés de fatigue, ils s’arment de courage pour assister à des fêtes où des joueurs de biniou font danser les foules imbibées de cidre et d’eau-de-vie.
Progressant vers l’ouest, le paysage sauvage de la presqu’île de Crozon les fascine : « Rien n’est beau comme ces grandes pentes vertes dressées presque d’aplomb sur l’étendue de la mer ». Au loin, déjà, la ville de Brest et son port qui, selon du Camp, « donne l’idée d’une grande nation ».
Après avoir remonté l’Elorn, ils coupent à travers les champs de pommes de terre et atteignent la cote déchiquetée de Saint-Pol-de-Léon.
Les voyageurs séjournent à Saint-Malo, cette « couronne de pierre posée sur les flots » avant de se rendre, en pèlerins, au Château de Combourg sur les traces de Chateaubriand. Sous les arbres du parc, ils lisent René et s’imprègnent de la vibrante mélancolie de son auteur.
Mais déjà, leur voyage touche à sa fin : « Bientôt allait finir cette fantaisie vagabonde que nous menions depuis trois mois avec tant de douceur ». De retour à Paris, ils assistent à la révolution de 1848 avant de repartir, ensemble, pour un voyage de trois ans en Orient…